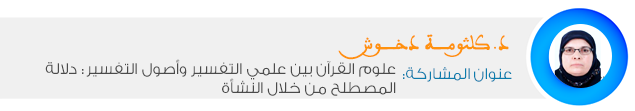Jaouad SERGHINI, FLSH, Université Mohammed 1er, Oujda, Maroc
Nul doute que ce XXIe siècle ait été celui des paradoxes : d’une part nous assistons à la prolifération des discours sur le rapprochement des peuples, sur la paix, la tolérance et le dialogue des civilisations des religions. D’autre part, la montée du fanatisme, du discours des adeptes de l’idéologie négationniste et de la prétendue thèse de choc des civilisations tant médiatisée. La réalité actuelle du monde c’est qu’il est pluriel, du coup l'imaginaire, le vocabulaire, le droit, l'économie et le politique sont transformés et en perpétuel changement afin de gérer cette pluralité. Le dialogue interculturel s’est trouvé une certaine légitimité au sein de cette diversité. Agissant comme un outil de rapprochement, le dialogue interculturel implique une double condition, d’abord reconnaître l’altérité de l’autre et son droit à la différence et ensuite se donner un cadre commun dans lequel un échange gagnant-gagnant peut s’instaurer entre les différentes entités réunies au sein du même territoire. Le dialogue interculturel est à la fois une utopie et une réalité et l’interculturel ne peut faire abstraction de ce que nous considérons être des résistances immunitaires que développe chaque culture et affiche ostensiblement au contact d’autres. L’interculturel ne se fait jamais sans conflit et contradictions car il a comme arrière-plan des représentations et des valeurs différentes que nourrissent les porteurs de cultures. Les intellectuels sont conscients de cet état de fait et agissent en conséquence : dans leurs écrits, ils essayent d'agir sur les mentalités et de faciliter la compréhension et la communication interculturelle entre les uns et les autres.
Notice biographique :
Jaouad SERGHINI, professeur Habilité (PH), Laboratoire Langues, Cultures et Traduction, (LCTrad) Département de Langue et Littérature Françaises, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed Premier, Oujda-Maroc.
Domaine de recherche : Littérature francophone- questions liées à l’interculturel- Littérature Comparée- dialogue des cultures et des religions.
Il a à son actif plusieurspublications :
- Les nouvelles tendances du roman maghrébin et subsaharien, Sarrebruck, Allemagne, éditions universitaires européennes, 2016. 347p.
- « Le nouveau roman africain, au carrefour des langues et des dialectes », International Journal of Francophone Studies, volume 18, n°1, mars 2015. http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-issue,id=2877/
- « Mabanckou l’intellectuel africain interverti », Revue Interculturel Francophonies, n ° 25, juin -juillet 2014.
- « L’intellectuel marocain face à l’interculturel, Mohammed Leftah comme exemple », in JournalFrancosphères, volume 2, n°1, 2013, Liverpool UniverstyPress.
- « L’écriture entre pays d’origine et pays d’accueil chez les écrivains africains », Revue Palabres, volume XII, n° 1& 2, Calgary, 2013.
- « La langue des écrivains subsahariens et maghrébins de la nouvelle génération de langue française », in Revue Synergies, numéro 6, année 2011, ISSN : 0718-0675, Santiago, Chili.
- « L’intertextualité africaine voie de la modernité », in la revue The AfricanStudentsResearch, numéro 1, décembre 2010.